
La Gouvernance : Mot ancien mais popularisé seulement à partir des années 90 , la gouvernance suggère un mode de gouvernement organisé sur la base d'une coopération, d'un partenariat ou d'un contrat, entre une pluralité d'acteurs aussi bien publics que privés.
À son tour, elle suscite l'émergence de néologismes ou éclaire sous un autre jour des notions plus anciennes.
AUTORITE L'émergence de la notion de gouvernance est certes liée à des nécessités économiques (globalisation) ou de politiques publiques, mais aussi à une transformation de la réalité du pouvoir et de l'autorité dans les sociétés actuelles. En effet, il n'y a pas si longtemps dans les sociétés occidentales, parfois aujourd'hui encore en certaines régions du monde, il existait des institutions dont les dirigeants et représentants étaient dotés d'un pouvoir légitime et d'une autorité incontestés.
Le prêtre, le représentant de l'Etat ou du parti, l'enseignant, etc. Or, en une trentaine d'années, ces figures ont perdu une bonne part de leur capacité d'imposer une conduite à leurs subordonnés. On ne dirige plus comme avant, et l'on n'accepte plus d'être gouverné ou dirigé comme avant.
Cette transformation de l'autorité et du pouvoir est liée à un bouleversement sans précédent des sociétés : généralisation de la scolarisation, activité professionnelle des femmes, accroissement de la consommation, transformation des emplois et des formes d'organisations, etc. Elle s'est accompagnée dans les sociétés développées d'une révolution des moeurs dont les maîtres mots sont « permissivité » et « individualisme ».
BIENS COMMUNS La notion de bien commun (comme pool ressources), issue du domaine de la gestion des ressources naturelles, s'appliquait à l'origine aux ressources utilisées par un groupe donné, à l'exclusion d'autres utilisateurs, comme la gestion d'un étang ou d'une prairie (contrairement aux biens publics dont l'usage est universel).
Reprise par les mouvements écologistes et environnementalistes, cette notion de bien commun a émergé sur la scène internationale dans les années 80, et notamment lors du premier sommet de la Terre, à Rio, en 1992. Elle recouvre alors un sens différent : des espèces, des entités biologiques et territoriales sont envisagées comme des biens vitaux pour l'humanité.
L'enjeu des biens communs porte sur leur gestion. Deux théories s'opposent : la première, de tradition anglo-saxonne, considère que confier des biens communs à des propriétaires permet de mieux les gérer ; la seconde, issue du droit romain, juge inacceptable le risque de voir certains accumuler des biens vitaux au détriment de personnes ou de populations. Elle prône une gestion régalienne (par des entités nationales ou supranationales) sur la base d'un statut patrimonial universel des biens, plutôt qu'à un système de marché.
BONNE GOUVERNANCE Dans nombre de pays en développement, les aides internationales sont détournées ou rendues inefficaces du fait de lourdeurs bureaucratiques ou du poids du clientélisme ; les réussites en la matière, quand elles existent, sont en fait à mettre à l'actif du dynamisme et de l'efficacité d'organisations non gouvernementales.
C'est sur la base de ce constat que la Banque mondiale avait, après avoir fait sienne la notion de gouvernance, introduit au milieu des années 90 l'idée de « bonne gouvernance ». Concrètement, elle recouvre des recommandations en faveur du dégonflement de l'Etat, des privatisations, du décloisonnement entre les secteurs public et privé, la limitation de la dette et des dépenses publiques, l'introduction des principes du new public management (soit un management des administrations calqué sur celui des entreprises) Depuis, la notion s'est diffusée à la faveur de publications et de colloques (certains financés par la Banque mondiale) tandis que d'autres organisations internationales faisaient leurs les objectifs de la bonne gouvernance.
A commencer par le FMI qui les a associés aux plans de réajustement structurel conditionnant l'octroi de ses prêts. Pour ses détracteurs, la bonne gouvernance n'est qu'un succédané des politiques ultralibérales et du Consensus de Washington établi dans les années 90.
CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance, gouvernement d'entreprise, gouvernance d'entreprise... De quoi parle-t-on exactement ? Le débat porte ici sur la relation entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprises, faut-il le préciser, cotées sur le marché financier. Selon cette analyse, après l'ère des managers, on serait passé à l'ère des actionnaires.
Ces derniers agents économiques sont dans un rapport d'incertitude, d'information incomplète vis-à-vis des dirigeants. Tout ceci remplit les actionnaires de suspicion, comme peuvent l'être les assureurs vis-à-vis de leurs assurés. N'y a-t-il pas des dissimulations dans les rapports financiers distribués aux actionnaires ? Les dirigeants servent-ils les intérêts de leurs actionnaires en recherchant une rentabilité maximale des capitaux investis ?
Cette première approche de la gouvernance a connu un franc succès suite aux divers scandales financiers qui ont secoué des entreprises comme Enron ou Vivendi. Dans une version plus extensive, la corporate governance questionne l'exercice du pouvoir dans l'entreprise au-delà des relations entre ses actionnaires et ses dirigeants.
Ceux que l'on appelle les stakeholders - les salariés et leurs représentants, les clients, les fournisseurs et les créanciers - sont intégrés dans le processus de gouvernance aux côtés des actionnaires. C'est cette définition que l'OCDE a retenue en 1999 pour édicter ces principes de « bonne gouvernance » et inciter les pays développés à élaborer « un cadre juridique et réglementaire qui doit régir l'organisation du pouvoir dans l'entreprise ».
COREGULATION Dans le fonctionnement concret de l'économie, une entreprise est enserrée dans un système de relations avec une diversité d'acteurs : entreprises mais aussi autorités administratives, syndicats, écoles professionnelles, etc. Une économie peut ainsi à un moment donné de son développement se caractériser par le mode dominant de régulation de ces relations. Tel est l'une des hypothèses qui sous-tendent les travaux de l'Ecole de la régulation qui se propose depuis la fin des années 60 d'analyser le capitalisme et ses transformations. Aussi curieux que cela puisse paraître, la notion de gouvernance n'est pas pour autant un concept clé de cette théorie ; elle ne figure pas dans le glossaire de Théorie de la régulation, l'état des savoirs (co-dirigé par Robert Boyer et Yves Saillard,
La Découverte, 2002) qui lui préfère encore la notion classique de gouvernement. Ce sont les analyses concrètes du fonctionnement des instances de régulation de différents secteurs (marchés financiers, télécommunications, transports aériens, etc.) qui replacent en définitive la notion de régulation dans la problématique de la gouvernance, fût-ce au prix d'un glissement sémantique au profit d'un néologisme : la corégulation. Comme le préfixe le suggère, il s'agit d'une régulation fabriquée conjointement par une pluralité d'acteurs : les entreprises et associations d'un secteur avec le concours des pouvoirs publics. En pratique, les entreprises du secteur tendent à imposer leur point de vue. C'est du moins ce qu'objectent les détracteurs du principe de corégulation.
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE Son émergence dans les années 1980-1990 est concomitante à celle des conférences de consensus ou des forums citoyens. Comme son nom l'indique, elle vise à encourager la participation directe des citoyens dans l'élaboration des décisions ou de politiques publiques. Pour cette raison, elle tend à être opposée à la démocratie représentative et, inversement, associée à l'idée d'une gouvernance citoyenne ou démocratique, par le bas en somme (qui s'opposerait à la gouvernance par le haut illustrée notamment par la bonne gouvernance édictée par les organisations internationales). Reste à savoir comment parvenir à une réelle participation des citoyens. Ceux qui participent ne sont-ils pas toujours les mêmes ou ceux ayant déjà la capacité de se faire entendre et de défendre leurs intérêts ? Autant de questions qui focalisent encore les débats autour de cette forme de démocratie. Aussi, d'aucuns préfèrent-ils la concevoir comme complémentaire avec la démocratie représentative (qui, elle, confère de surcroît une légitimité aux représentants par le jeu du processus électoral) en la circonscrivant à la démocratie locale ou municipale (régies de quartier, budget participatif, etc.). Ce à quoi d'autres objectent (sans toujours convaincre) les nouvelles potentialités offertes par Internet et la démocratie électronique en matière de délibération et de vote à distance.
FORUM Forum social mondial (de Porto Alegre et plus récemment de Bombay), Forum social européen, forum économique de Davos mais aussi forums de citoyens, forums de discussion, etc. La notion de forum a fait un retour en force au cours de ces dernières années en même temps que les notions de démocratie participative ou délibérative, sans oublier celle de gouvernance. Sans que le rapport soit immédiat entre le principe du forum et cette dernière, on y retrouve une même idée : la confrontation dans un processus de concertation ou de délibération d'acteurs de différents horizons professionnels et sociaux, porteurs d'intérêts pas nécessairement convergents.
GLOBAL/LOCAL Traiter un problème dans ses différentes dimensions (économique, politique, environnementale, sociale, etc.) à partir de solutions portées par des expériences ou initiatives locales pour éviter de plaquer des modèles ne prenant pas en compte les spécificités du contexte. C'est le principe résumé par le fameux slogan mis en avant par des multinationales ou des organisations internationales : « Penser global, agir local. » Cette nécessité de mieux articuler les échelles a très largement justifié la substitution de la notion de gouvernance à celle de gouvernement. Elle a été encouragée par un autre constat : la présence au sein d'une ville ou d'un Etat d'une pluralité d'acteurs dont certains relèvent de logiques supranationales (comme par exemple la filiale d'une multinationale qui, tout en satisfaisant à la législation du pays d'accueil, concourt aux intérêts de sa maison mère). Un enchevêtrement des logiques locale, nationale, mondiale, que les Anglo-Saxons ont rendu par l'expression de multi level governance (gouvernance multi niveau). Laquelle trouve une illustration avec le principe de subsidiarité appliqué par les instances de l'Union européenne.
INSTITUTION Au sens de l'approche (néo)institutionnaliste ou des écoles de la régulation et des conventions, désigne les procédures, protocoles, normes et conventions aussi bien officiels qu'officieux, explicites ou implicites qui sous-tendent le comportement des acteurs de la vie socioéconomique. Les institutions sont d'autant plus à prendre en considération qu'elles permettent de comprendre le fonctionnement concret des marchés.
Parce qu'elles façonnent les « styles » nationaux de politique publique, elles peuvent aussi expliquer les différences qui subsistent entre les économies nationales et leur mode de gouvernance, malgré le contexte de mondialisation. Parmi les travaux représentatifs de ce courant, citons ceux de Peter Hall et David Soskice qui montrent comment les relations des entreprises avec les administrations, les partenaires sociaux, les établissements d'enseignement supérieur ou professionnel, etc., donnent un style particulier au capitalisme du pays .
PARTENARIAT Des partenariats entre des municipalités et des associations, des entreprises et/ou des fondations, telle est l'une des tendances qui a justifié à partir des années 80 en Angleterre, 90 en France, l'introduction de l'idée de « gouvernance urbaine » en lieu et place du terme de gouvernement qui connote, lui, une stricte séparation entre le public et le privé. Par extension, l'idée de partenariat a été invoquée en France pour caractériser les nouveaux rapports entre l'Etat, les collectivités locales et des entreprises publiques, à la faveur de la conclusion de contrats ( Etat-Région, Etat -entreprise), mais aussi entre les entreprises dans le contexte de la mondialisation et de la nouvelle économie numérique.
Même concurrentes, celles-ci peuvent en effet s'engager dans des coopérations provisoires et ciblées (en recherche et développement notamment). C'est pour rendre compte de ces partenariats ponctuels qu'a été forgé le néologisme de « coopétition » (contraction de coopération et de compétition).
POLITIQUES PUBLIQUES Dans le livre récent qu'il leur a consacré (Politiques et actions publiques, Armand Colin, 2003), le politologue Gilles Massardier définit les politiques publiques comme « les dispositifs tangibles (un budget, du droit, des institutions spécialisées...) qui régissent un secteur de la société ou une activité (industrie chimique, agriculture, développement économique...), voire un projet (aménagement routier, ferroviaire...) des dispositifs issus d'une fabrication sociale collective et complexe par des acteurs (individus, entreprises, associations...) ou groupes d'acteurs (organisations professionnelles, mobilisations sociales plus sporadiques...), et des institutions publiques (nationales, locales) voire des organisations internationales ».
C'est dire si on est loin de la conception classique et, pour tout dire, obsolète qui en imputait la responsabilité aux seules autorités publiques (ministres, fonctionnaires et préfets) agissant à partir d'objectifs et de moyens définis a priori et perçues elles-mêmes comme extérieures ou au-dessus de la société. Pour autant, l'Etat n'est pas en passe de s'effacer, il est toujours présent mais autrement, observe G. Massardier. Une évolution dans le sens d'une recomposition, accentuée en France par la décentralisation et la construction européenne et qui a largement encouragé, sur un plan théorique, les approches des politiques publiques en termes de policy making et de gouvernance.
RATIONALITE LIMITEE Modèle canonique de l'économie néoclassique, l'Homo oeconomicus est un être désincarné, parfaitement rationnel dont l'objectif est de maximiser sa satisfaction s'il est un consommateur, ou son profit s'il est un producteur. En 1947, Herbert Simon propose de substituer à la maximisation la rationalité limitée.
Parce que les capacités cognitives des individus sont finies et que leurs connaissances sont imparfaites, ils ne cherchent pas la solution optimale mais celle qui est la plus satisfaisante. A ce premier coup de canif au modèle néoclassique succède un second dans les années 70.
Pour H. Simon, les choix des individus ne peuvent être compris sans entrer dans la boîte noire de leur fonctionnement décisionnel. Alors la psychologie vient au secours de l'économie pour décrypter les mécanismes de décision, et la rationalité devient « procédurale » car elle se révèle dans le processus même de la décision.
L'économie expérimentale portée par le prix Nobel 2002 Daniel Kahneman prolonge les travaux réalisés par H. Simon et confirme l'irréalisme des postulats forgés autour du modèle. La rationalité pure et parfaite est une construction théorique qui date de plus d'un siècle.
REFERENTIEL Désigne les normes mais aussi les représentations ou croyances partagées par des acteurs agissant collectivement. L'existence de ces référentiels a été notamment mise en évidence par les analyses des politiques publiques. En effet, pas d'action publique sans de tels référentiels. C'est ce que s'attache à montrer l'approche cognitive des politiques publiques illustrées en France par les travaux du politologue Pierre Muller.
Un référentiel n'est pas donné mais fabriqué ; il n'offre pas seulement une image cohérente d'un secteur économique mais construit aussi une vision situant la place de ce secteur dans la société prise dans son ensemble (voir les points de repère, p. 44). Ce rôle des référentiels a également été mis en évidence par l'économiste André Orléans dans son analyse du fonctionnement des marchés financiers et du comportement des investisseurs et spéculateurs (voir Le Pouvoir de la finance, Odile Jacob, 1999).
SOCIETE CIVILE Le concept de société civile puise sa source dans le droit romain et la tradition occidentale du droit naturel pour qui la société politique et la société civile sont une seule et même chose. Elles s'opposaient pour le philosophe John Locke à l'état de nature.
C'est à partir de Thomas Hobbes au xviie siècle et surtout de Georg W.F. Hegel entre les xviiie et xixe siècles, que l'Etat est défini comme une structure institutionnelle distincte de la société civile. Cette dernière est supposée permettre la perpétuation du lien communautaire dans des sociétés modernes de type individualiste.
Le 20ème siècle, dans sa plus grande partie, a ignoré la réflexion sur la société civile et c'est seulement à partir d'une critique de gauche des partis communistes issue des réflexions d'Antonio Gramsci, dans les années 60, que le concept a réémergé.
On s'est mis à valoriser les mouvements sociaux et les associations non politiques ou non étatiques, comme des alternatives aux dérives de l'étatisme, qu'il fût capitaliste ou socialiste. La discussion sur la question de la société civile pose aujourd'hui avant tout la question du lien politique et de la citoyenneté.
Elle pose aussi la question de la nature d'une société. Il est très compliqué de distinguer, dans les sociétés contemporaines, l'Etat des instruments de son intervention politique. Et les ONG ou associations qui forment la société civile sont totalement insérées dans les dispositifs de politique publique, par leurs financements, mais aussi par leurs fonctionnements ou leurs justifications.
Texte tiré de la Revue Sciences Humaines.
À son tour, elle suscite l'émergence de néologismes ou éclaire sous un autre jour des notions plus anciennes.
AUTORITE L'émergence de la notion de gouvernance est certes liée à des nécessités économiques (globalisation) ou de politiques publiques, mais aussi à une transformation de la réalité du pouvoir et de l'autorité dans les sociétés actuelles. En effet, il n'y a pas si longtemps dans les sociétés occidentales, parfois aujourd'hui encore en certaines régions du monde, il existait des institutions dont les dirigeants et représentants étaient dotés d'un pouvoir légitime et d'une autorité incontestés.
Le prêtre, le représentant de l'Etat ou du parti, l'enseignant, etc. Or, en une trentaine d'années, ces figures ont perdu une bonne part de leur capacité d'imposer une conduite à leurs subordonnés. On ne dirige plus comme avant, et l'on n'accepte plus d'être gouverné ou dirigé comme avant.
Cette transformation de l'autorité et du pouvoir est liée à un bouleversement sans précédent des sociétés : généralisation de la scolarisation, activité professionnelle des femmes, accroissement de la consommation, transformation des emplois et des formes d'organisations, etc. Elle s'est accompagnée dans les sociétés développées d'une révolution des moeurs dont les maîtres mots sont « permissivité » et « individualisme ».
BIENS COMMUNS La notion de bien commun (comme pool ressources), issue du domaine de la gestion des ressources naturelles, s'appliquait à l'origine aux ressources utilisées par un groupe donné, à l'exclusion d'autres utilisateurs, comme la gestion d'un étang ou d'une prairie (contrairement aux biens publics dont l'usage est universel).
Reprise par les mouvements écologistes et environnementalistes, cette notion de bien commun a émergé sur la scène internationale dans les années 80, et notamment lors du premier sommet de la Terre, à Rio, en 1992. Elle recouvre alors un sens différent : des espèces, des entités biologiques et territoriales sont envisagées comme des biens vitaux pour l'humanité.
L'enjeu des biens communs porte sur leur gestion. Deux théories s'opposent : la première, de tradition anglo-saxonne, considère que confier des biens communs à des propriétaires permet de mieux les gérer ; la seconde, issue du droit romain, juge inacceptable le risque de voir certains accumuler des biens vitaux au détriment de personnes ou de populations. Elle prône une gestion régalienne (par des entités nationales ou supranationales) sur la base d'un statut patrimonial universel des biens, plutôt qu'à un système de marché.
BONNE GOUVERNANCE Dans nombre de pays en développement, les aides internationales sont détournées ou rendues inefficaces du fait de lourdeurs bureaucratiques ou du poids du clientélisme ; les réussites en la matière, quand elles existent, sont en fait à mettre à l'actif du dynamisme et de l'efficacité d'organisations non gouvernementales.
C'est sur la base de ce constat que la Banque mondiale avait, après avoir fait sienne la notion de gouvernance, introduit au milieu des années 90 l'idée de « bonne gouvernance ». Concrètement, elle recouvre des recommandations en faveur du dégonflement de l'Etat, des privatisations, du décloisonnement entre les secteurs public et privé, la limitation de la dette et des dépenses publiques, l'introduction des principes du new public management (soit un management des administrations calqué sur celui des entreprises) Depuis, la notion s'est diffusée à la faveur de publications et de colloques (certains financés par la Banque mondiale) tandis que d'autres organisations internationales faisaient leurs les objectifs de la bonne gouvernance.
A commencer par le FMI qui les a associés aux plans de réajustement structurel conditionnant l'octroi de ses prêts. Pour ses détracteurs, la bonne gouvernance n'est qu'un succédané des politiques ultralibérales et du Consensus de Washington établi dans les années 90.
CORPORATE GOVERNANCE Corporate governance, gouvernement d'entreprise, gouvernance d'entreprise... De quoi parle-t-on exactement ? Le débat porte ici sur la relation entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprises, faut-il le préciser, cotées sur le marché financier. Selon cette analyse, après l'ère des managers, on serait passé à l'ère des actionnaires.
Ces derniers agents économiques sont dans un rapport d'incertitude, d'information incomplète vis-à-vis des dirigeants. Tout ceci remplit les actionnaires de suspicion, comme peuvent l'être les assureurs vis-à-vis de leurs assurés. N'y a-t-il pas des dissimulations dans les rapports financiers distribués aux actionnaires ? Les dirigeants servent-ils les intérêts de leurs actionnaires en recherchant une rentabilité maximale des capitaux investis ?
Cette première approche de la gouvernance a connu un franc succès suite aux divers scandales financiers qui ont secoué des entreprises comme Enron ou Vivendi. Dans une version plus extensive, la corporate governance questionne l'exercice du pouvoir dans l'entreprise au-delà des relations entre ses actionnaires et ses dirigeants.
Ceux que l'on appelle les stakeholders - les salariés et leurs représentants, les clients, les fournisseurs et les créanciers - sont intégrés dans le processus de gouvernance aux côtés des actionnaires. C'est cette définition que l'OCDE a retenue en 1999 pour édicter ces principes de « bonne gouvernance » et inciter les pays développés à élaborer « un cadre juridique et réglementaire qui doit régir l'organisation du pouvoir dans l'entreprise ».
COREGULATION Dans le fonctionnement concret de l'économie, une entreprise est enserrée dans un système de relations avec une diversité d'acteurs : entreprises mais aussi autorités administratives, syndicats, écoles professionnelles, etc. Une économie peut ainsi à un moment donné de son développement se caractériser par le mode dominant de régulation de ces relations. Tel est l'une des hypothèses qui sous-tendent les travaux de l'Ecole de la régulation qui se propose depuis la fin des années 60 d'analyser le capitalisme et ses transformations. Aussi curieux que cela puisse paraître, la notion de gouvernance n'est pas pour autant un concept clé de cette théorie ; elle ne figure pas dans le glossaire de Théorie de la régulation, l'état des savoirs (co-dirigé par Robert Boyer et Yves Saillard,
La Découverte, 2002) qui lui préfère encore la notion classique de gouvernement. Ce sont les analyses concrètes du fonctionnement des instances de régulation de différents secteurs (marchés financiers, télécommunications, transports aériens, etc.) qui replacent en définitive la notion de régulation dans la problématique de la gouvernance, fût-ce au prix d'un glissement sémantique au profit d'un néologisme : la corégulation. Comme le préfixe le suggère, il s'agit d'une régulation fabriquée conjointement par une pluralité d'acteurs : les entreprises et associations d'un secteur avec le concours des pouvoirs publics. En pratique, les entreprises du secteur tendent à imposer leur point de vue. C'est du moins ce qu'objectent les détracteurs du principe de corégulation.
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE Son émergence dans les années 1980-1990 est concomitante à celle des conférences de consensus ou des forums citoyens. Comme son nom l'indique, elle vise à encourager la participation directe des citoyens dans l'élaboration des décisions ou de politiques publiques. Pour cette raison, elle tend à être opposée à la démocratie représentative et, inversement, associée à l'idée d'une gouvernance citoyenne ou démocratique, par le bas en somme (qui s'opposerait à la gouvernance par le haut illustrée notamment par la bonne gouvernance édictée par les organisations internationales). Reste à savoir comment parvenir à une réelle participation des citoyens. Ceux qui participent ne sont-ils pas toujours les mêmes ou ceux ayant déjà la capacité de se faire entendre et de défendre leurs intérêts ? Autant de questions qui focalisent encore les débats autour de cette forme de démocratie. Aussi, d'aucuns préfèrent-ils la concevoir comme complémentaire avec la démocratie représentative (qui, elle, confère de surcroît une légitimité aux représentants par le jeu du processus électoral) en la circonscrivant à la démocratie locale ou municipale (régies de quartier, budget participatif, etc.). Ce à quoi d'autres objectent (sans toujours convaincre) les nouvelles potentialités offertes par Internet et la démocratie électronique en matière de délibération et de vote à distance.
FORUM Forum social mondial (de Porto Alegre et plus récemment de Bombay), Forum social européen, forum économique de Davos mais aussi forums de citoyens, forums de discussion, etc. La notion de forum a fait un retour en force au cours de ces dernières années en même temps que les notions de démocratie participative ou délibérative, sans oublier celle de gouvernance. Sans que le rapport soit immédiat entre le principe du forum et cette dernière, on y retrouve une même idée : la confrontation dans un processus de concertation ou de délibération d'acteurs de différents horizons professionnels et sociaux, porteurs d'intérêts pas nécessairement convergents.
GLOBAL/LOCAL Traiter un problème dans ses différentes dimensions (économique, politique, environnementale, sociale, etc.) à partir de solutions portées par des expériences ou initiatives locales pour éviter de plaquer des modèles ne prenant pas en compte les spécificités du contexte. C'est le principe résumé par le fameux slogan mis en avant par des multinationales ou des organisations internationales : « Penser global, agir local. » Cette nécessité de mieux articuler les échelles a très largement justifié la substitution de la notion de gouvernance à celle de gouvernement. Elle a été encouragée par un autre constat : la présence au sein d'une ville ou d'un Etat d'une pluralité d'acteurs dont certains relèvent de logiques supranationales (comme par exemple la filiale d'une multinationale qui, tout en satisfaisant à la législation du pays d'accueil, concourt aux intérêts de sa maison mère). Un enchevêtrement des logiques locale, nationale, mondiale, que les Anglo-Saxons ont rendu par l'expression de multi level governance (gouvernance multi niveau). Laquelle trouve une illustration avec le principe de subsidiarité appliqué par les instances de l'Union européenne.
INSTITUTION Au sens de l'approche (néo)institutionnaliste ou des écoles de la régulation et des conventions, désigne les procédures, protocoles, normes et conventions aussi bien officiels qu'officieux, explicites ou implicites qui sous-tendent le comportement des acteurs de la vie socioéconomique. Les institutions sont d'autant plus à prendre en considération qu'elles permettent de comprendre le fonctionnement concret des marchés.
Parce qu'elles façonnent les « styles » nationaux de politique publique, elles peuvent aussi expliquer les différences qui subsistent entre les économies nationales et leur mode de gouvernance, malgré le contexte de mondialisation. Parmi les travaux représentatifs de ce courant, citons ceux de Peter Hall et David Soskice qui montrent comment les relations des entreprises avec les administrations, les partenaires sociaux, les établissements d'enseignement supérieur ou professionnel, etc., donnent un style particulier au capitalisme du pays .
PARTENARIAT Des partenariats entre des municipalités et des associations, des entreprises et/ou des fondations, telle est l'une des tendances qui a justifié à partir des années 80 en Angleterre, 90 en France, l'introduction de l'idée de « gouvernance urbaine » en lieu et place du terme de gouvernement qui connote, lui, une stricte séparation entre le public et le privé. Par extension, l'idée de partenariat a été invoquée en France pour caractériser les nouveaux rapports entre l'Etat, les collectivités locales et des entreprises publiques, à la faveur de la conclusion de contrats ( Etat-Région, Etat -entreprise), mais aussi entre les entreprises dans le contexte de la mondialisation et de la nouvelle économie numérique.
Même concurrentes, celles-ci peuvent en effet s'engager dans des coopérations provisoires et ciblées (en recherche et développement notamment). C'est pour rendre compte de ces partenariats ponctuels qu'a été forgé le néologisme de « coopétition » (contraction de coopération et de compétition).
POLITIQUES PUBLIQUES Dans le livre récent qu'il leur a consacré (Politiques et actions publiques, Armand Colin, 2003), le politologue Gilles Massardier définit les politiques publiques comme « les dispositifs tangibles (un budget, du droit, des institutions spécialisées...) qui régissent un secteur de la société ou une activité (industrie chimique, agriculture, développement économique...), voire un projet (aménagement routier, ferroviaire...) des dispositifs issus d'une fabrication sociale collective et complexe par des acteurs (individus, entreprises, associations...) ou groupes d'acteurs (organisations professionnelles, mobilisations sociales plus sporadiques...), et des institutions publiques (nationales, locales) voire des organisations internationales ».
C'est dire si on est loin de la conception classique et, pour tout dire, obsolète qui en imputait la responsabilité aux seules autorités publiques (ministres, fonctionnaires et préfets) agissant à partir d'objectifs et de moyens définis a priori et perçues elles-mêmes comme extérieures ou au-dessus de la société. Pour autant, l'Etat n'est pas en passe de s'effacer, il est toujours présent mais autrement, observe G. Massardier. Une évolution dans le sens d'une recomposition, accentuée en France par la décentralisation et la construction européenne et qui a largement encouragé, sur un plan théorique, les approches des politiques publiques en termes de policy making et de gouvernance.
RATIONALITE LIMITEE Modèle canonique de l'économie néoclassique, l'Homo oeconomicus est un être désincarné, parfaitement rationnel dont l'objectif est de maximiser sa satisfaction s'il est un consommateur, ou son profit s'il est un producteur. En 1947, Herbert Simon propose de substituer à la maximisation la rationalité limitée.
Parce que les capacités cognitives des individus sont finies et que leurs connaissances sont imparfaites, ils ne cherchent pas la solution optimale mais celle qui est la plus satisfaisante. A ce premier coup de canif au modèle néoclassique succède un second dans les années 70.
Pour H. Simon, les choix des individus ne peuvent être compris sans entrer dans la boîte noire de leur fonctionnement décisionnel. Alors la psychologie vient au secours de l'économie pour décrypter les mécanismes de décision, et la rationalité devient « procédurale » car elle se révèle dans le processus même de la décision.
L'économie expérimentale portée par le prix Nobel 2002 Daniel Kahneman prolonge les travaux réalisés par H. Simon et confirme l'irréalisme des postulats forgés autour du modèle. La rationalité pure et parfaite est une construction théorique qui date de plus d'un siècle.
REFERENTIEL Désigne les normes mais aussi les représentations ou croyances partagées par des acteurs agissant collectivement. L'existence de ces référentiels a été notamment mise en évidence par les analyses des politiques publiques. En effet, pas d'action publique sans de tels référentiels. C'est ce que s'attache à montrer l'approche cognitive des politiques publiques illustrées en France par les travaux du politologue Pierre Muller.
Un référentiel n'est pas donné mais fabriqué ; il n'offre pas seulement une image cohérente d'un secteur économique mais construit aussi une vision situant la place de ce secteur dans la société prise dans son ensemble (voir les points de repère, p. 44). Ce rôle des référentiels a également été mis en évidence par l'économiste André Orléans dans son analyse du fonctionnement des marchés financiers et du comportement des investisseurs et spéculateurs (voir Le Pouvoir de la finance, Odile Jacob, 1999).
SOCIETE CIVILE Le concept de société civile puise sa source dans le droit romain et la tradition occidentale du droit naturel pour qui la société politique et la société civile sont une seule et même chose. Elles s'opposaient pour le philosophe John Locke à l'état de nature.
C'est à partir de Thomas Hobbes au xviie siècle et surtout de Georg W.F. Hegel entre les xviiie et xixe siècles, que l'Etat est défini comme une structure institutionnelle distincte de la société civile. Cette dernière est supposée permettre la perpétuation du lien communautaire dans des sociétés modernes de type individualiste.
Le 20ème siècle, dans sa plus grande partie, a ignoré la réflexion sur la société civile et c'est seulement à partir d'une critique de gauche des partis communistes issue des réflexions d'Antonio Gramsci, dans les années 60, que le concept a réémergé.
On s'est mis à valoriser les mouvements sociaux et les associations non politiques ou non étatiques, comme des alternatives aux dérives de l'étatisme, qu'il fût capitaliste ou socialiste. La discussion sur la question de la société civile pose aujourd'hui avant tout la question du lien politique et de la citoyenneté.
Elle pose aussi la question de la nature d'une société. Il est très compliqué de distinguer, dans les sociétés contemporaines, l'Etat des instruments de son intervention politique. Et les ONG ou associations qui forment la société civile sont totalement insérées dans les dispositifs de politique publique, par leurs financements, mais aussi par leurs fonctionnements ou leurs justifications.
Texte tiré de la Revue Sciences Humaines.
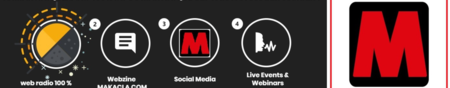

 Accueil
Accueil











