NOUS EXIGEONS L’ABOLITION IMMEDIATE DU STATUT JURIDIQUE D’AFFRANCHI
Par Dominique MONOTUKA
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Fort-de-France
Tout juriste ou historien de bonne foi, est en mesure de constater que le statut qui nous est appliqué aujourd’hui, celui d’assimilation juridique, dit encore de département d’outre-mer, est celui d’affranchi du Code Noir généralisé à tous les Afro-descendants depuis le décret du 27 avril 1848.
Cette connaissance juridique n’était jadis niée par personne dans la colonie.
Ni par les Blancs, ni par les Afro-descendants.
C’est vain d'essayer comme le fait certains, de cacher cette vérité plus longtemps qui démontre aux Martiniquais que leur île, effectivement, est et demeure juridiquement une colonie au sens propre du terme.
Le 29 septembre 1848, Victor SCHOELCHER, s’adressant aux électeurs de la Guadeloupe et de la Martinique, en parlait sans honte ni ignorance :
« i[Moi, de mon côté, à l’Assemblée nationale où vos suffrages me donnent une place, je vous aiderai de toutes mes forces […] en provoquant et soutenant toutes les mesures propres à augmenter la prospérité des colonies, et leur complète assimilation à la France. Purifiées de la servitude, les colonies sont désormais une partie intégrante de la métropole ; disons mieux, il n’y a plus de colonies, il n’y a que des départements d’outre-mer qui doivent être régis par les mêmes lois que ceux du continent.
Mais qu’il me soit permis de vous le rappeler, frères et amis, tout ce que la France est disposée à faire pour ses départements d’outre-mer serait perdu si la discorde venait troubler leurs populations ]i» (cité dans Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, Editions Karthala, 2000, pp.1026-1027).
Le Conseil Général de la Martinique avec en son sein des Afro-descendants, assumait lui aussi ouvertement cette vérité. Le 24 novembre 1874, il adressait par exemple une requête à l’Etat français qui, s’il en était besoin, permet de démontrer la conscience qu’en avaient ces affranchis :
« Considérant que la qualité et les droits de citoyen français datent, pour les habitants des Antilles, de la fondation des colonies, que c’est le roi Louis XIII qui, dans son édit de 1642, concernant l’établissement de la Compagnie des îles d’Amérique, a voulu et ordonné : ‘‘ Que les descendants des Français habitués aux dites îles, et même les sauvages convertis à la foi chrétienne, en faisant profession, soient censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions et donations, ainsi que les originaires et regnicoles, sans être tenus de prendre lettre de naturalité...’’
i[Que loin d’être abrogée à la reprise des colonies par le roi Louis XIV sur les seigneurs, cette disposition a été confirmée, octroyée aux affranchis par l’article 59 de l’Edit de 1685 […]
Considérant donc qu’en accordant les droits politiques aux populations coloniales en 1848 et en 1870, le gouvernement n’a fait que consacrer à nouveau des droits acquis antérieurement et remettre la pyramide sur sa base suivant une parole célèbre reproduite dans la pétition du Sénat de 1865.
[..] ‘‘Qu’il y aurait lieu de soustraire les colonies au régime exceptionnel et de les faire jouir des lois et de l’administration de la Mère-Patrie, en prenant pour devise de ce grand mouvement réparateur : assimilation politique des colonies à la Mère-Patrie.’’ Émet le vœu : que les lois constitutionnelles attendues, particulièrement la loi électorale, comprennent les colonies comme terres françaises, parties intégrantes de la République, soumises à la même loi constitutionnelle, admise définitivement à la jouissance des lois et de l’Administration française ]i»
(cité dans Victor SABLÉ, La transformation des isles d’Amérique en départements français, pp. 89-92).
Le 7 décembre 1882, ce même Conseil Général persiste :
« i[Considérant que la Martinique qui est française depuis plus de deux siècles, qui jouit depuis 1870 des mêmes droits politiques que la métropole, se trouve dans les meilleures conditions possibles pour être assimilée complètement avec la mère-patrie.
Considérant qu’il importe de faire disparaître les différences humiliantes qui existent entre la colonie et un département français. […]Renouvelle en l’accentuant le vœu qu’il a émis le 24 novembre 1874 et demande que la Martinique soit constituée le plus tôt possible en département français ]i» (cité dans Victor SABLÉ, La transformation des isles d’Amérique en départements français, pp. 91-92).
Mais la conscience claire que le statut d’affranchi généralisé est celui de département d’outre-mer ne s’est malheureusement pas transmise jusqu’à nous.
En effet, bien que les élus martiniquais aient su que le statut d’affranchi était l’ordre qui nous régentait collectivement depuis 1848 ; bien qu’ils aient su et aient reconnu parfaitement que le statut d’affranchi était le même que celui d’assimilation et de département d’outre-mer, dont ils demandaient par conséquent l’application pleine et entière – comme nos élus des cinquante dernières années ont continué de réclamer – par la mise en œuvre d’une politique de rattrapage (politique que le Conseil général désigne dans sa requête de 1874 comme étant le « grand mouvement réparateur ») .
Nous allons assister durant la première moitié du 20e siècle à une étrange absence de transmission aux Martiniquais de cette mémoire, pourtant si essentielle pour la compréhension et la résolution de notre malaise identitaire colonial.
Il convient donc aujourd’hui et plus que jamais de reconquérir cette mémoire pour en tirer toutes les conséquences utiles. Parce que ce n’est évidemment pas dû au hasard si l’Etat français a continué jusqu’à aujourd’hui à nous maintenir appliqué le statut d’affranchi.
C’est en effet parce que sa Commission d'abolition de l'esclavage a été aussi convaincue que lui – en raison notamment de son échec face à la révolte de Saint-Domingue qui, en 1804, couronnait l’avènement d’Haïti – qu’il fallait immédiatement abolir le statut d’esclave et généraliser en parallèle le statut d’affranchi pour arriver à conserver entre ses mains la situation coloniale en Martinique, c’est-à-dire pour empêcher que cette terre et la main d’œuvre que continuent d’y constituer les Afro-descendants n’échappent à sa domination codifiée.
Le premier Rapport fait au Ministre de la Marine et des Colonies par la Commission d’émancipation, Commission instituée par l’Etat français pour préparer l’acte d’abolition immédiate de l’esclavage, expose clairement cette cynique analyse politique :
« L’esclavage, tout le monde en convient, et les colons sont d’accord pour le reconnaître, l’esclavage ne pouvait plus être maintenu, et l’on devra se réputer heureux si l’on a traversé sans secousse le court intervalle qui a dû séparer la proclamation de la République et l’annonce du prochain affranchissement. […]
Plus d’accommodement possible avec la servitude ; tout accommodement, comme tout mensonge, soulèverait les nègres et mettrait en péril l’existence même des colonies. Saint-domingue est là pour nous dire ce que l’on gagne à marchander, à des hommes qui veulent être libres, leur droit à la liberté.
C’est l’esclavage qui, en paralysant le travail, les a maintenues (les colonies) soit pour l’agriculture, soit pour l’industrie, à un degré si triste d’infériorité vis-à-vis de la métropole.
L’instrument humain dont on faisait usage sembla, pendant bien longtemps, dispenser le maître du moindre effort pour le bien diriger. L’agriculture employait à peine la charrue : jamais on ne fit un tel abus des forces brutes de l’homme. […] Il y avait donc une énorme déperdition de forces ; il y avait une perte énorme de produits ; et nous ne craignons pas de l’affirmer, le travail dût-il compter moins de bras, la production pourrait s’élever encore par le meilleur emploi de ceux qui resteront, le perfectionnement des instruments et la réforme des méthodes » (cité dans Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, Editions Karthala, 2000, p. 976).
Aussi, arrivaient-ils à leur fin : ce que l’Etat et sa Commission cherchaient en 1848 à gagner à marchander notre droit à la liberté, et finissaient par obtenir, est précisément notre maintient sous le statut d’affranchi.
C’est la cohérence et l’efficacité permanente du système esclavagiste qui l’exigeaient.
Les fondateurs du Code Noir étaient et demeurent intéressés uniquement – il convient de ne jamais l’oublier – par la force de travail (physique et intellectuelle) que les Afro-descendants constituent, et non point par ce qui nous distingue des animaux, je veux dire notre civilisation, notre culture qu’ils méprisent.
Et c’est ce qui explique leur décision de nous imposer systématiquement que des identités juridiques exclusives de notre être culturel (esclave, meuble et affranchi).
Car contrairement aux apparences, ce qui caractérise substantiellement la qualification juridique d’affranchi, est exactement le même crime contenu dans la qualification juridique d’esclave : l’un et l’autre ne reconnaissent point aux hommes et aux femmes auxquels ils s’appliquent la qualité fondamentale d’êtres de civilisation et de culture, donc de personne humaine.
Jadis, les Afro-descendants dénonçaient avec une admirable lucidité cette inacceptable déni d’humanité contenu dans ce statut, ainsi que ses détestables effets y compris celui de les handicaper en permanence dans leur propre pays par rapport aux colons.
Ce fut le cas par exemple d’affranchis de la Guadeloupe en 1840 : i[« […], nous mettons en usage les seuls moyens que nous ayons en notre pouvoir, ceux que nous tenons de la nature, nous voulons dire nos faibles talents, les faibles lumières de notre raison, et surtout la conscience de la dignité de notre être.
C’est avec ces armes, puissantes pour qui sait s’en servir, que nous combattons les préjugés qui planent encore sur nous, et qui ne se dissiperont que lorsque les contrées que nous habitons, n’étant plus frappées de cette prétendue naturelle incapacité, cesseront d’être considérées comme ne devant être jamais dignes de la liberté et de la civilisation ]i»
(cité dans Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, Editions Karthala, 2000, p. 682).
Par conséquent, la condition d’indignité humaine que nous éprouvons quotidiennement, n’est pas le fruit de notre imagination ni du hasard. Si l’on veut bien se rappeler que le droit, qui est une production humaine, est de la culture (ou encore de la civilisation) et que la culture est d’abord et avant tout du droit (des règles sociales).
Alors on comprendra que continuer d’œuvrer dans notre société sous le régime d’affranchi, nous réduit effectivement à ne pouvoir protéger et faire survivre notre culture (règles sociales) que dans des espaces privés de plus en plus réduits, et même souvent dans la clandestinité.
On comprendra aussi pourquoi, qu’en dépit du talent de nos artistes, de l’activisme de nos associations culturelles, de la volonté courageuse de certains de nos enseignants dans les institutions scolaires ou universitaires, de nous transmettre notre culture, nous sommes et demeurons dépossédés des moyens de faire œuvre de civilisation à la hauteur de nos ambitions, de sauvegarder comme il se doit, dignement, notre identité culturelle.
On comprendra une fois pour toutes qu’en effet, frappés comme nous le sommes dans le système juridique qui nous régente, de l’incapacité juridique de traduire notre culture en l’officiel droit public devant nous régir, est la conservation intacte et exacte de la négation même de notre droit à une identité de personne humaine.
Et pour cause ! La condition d’indignité humaine que nous éprouvons quotidiennement, c’est l’institutionnalisation à notre encontre de la règle politico-juridique selon laquelle, la manière de soumettre et d’instrumentaliser une population est l’écrasement de sa mémoire historique, la destruction de sa culture, l’épuisement de ses symboles patrimoniaux et identitaires.
La condition d’indignité humaine que nous continuons de subir chaque jour qui passe, c’est le statut d’affranchi, ce maintien raciste de l’application du Code noir qui gangrène toutes les institutions publiques et privées en Martinique.
C’est cette exclusion raciste de notre culture de l’élaboration et de l’application des institutions publiques qui nous gouvernent (droit civil, du travail, de l’éducation, de l’économie, de la justice…).
C’est pourquoi, il est plus que jamais urgent que nous allions plus loin pour la renaissance pleine et entière de notre dignité en droit, en appliquant immédiatement le statut de personne humaine au profit de notre population martiniquaise.
Je rappelle tout de même que depuis la Constitution de 1946, le statut d’affranchi dit encore d’assimilation juridique est devenu anticonstitutionnel. La Constitution française de 1946 nous a en effet reconnu – malgré elle manifestement – le statut juridique de personne humaine.
Mais l’Etat français n’a jamais procédé à son application puisqu’il nous a maintenu celle du statut d’affranchi, avec notamment la complicité du Conseil d’Etat. Mais les Martiniquais ne veulent et ne peuvent plus survivre dans ce déni d’humanité qui de surplus est illégal.
Notre force culturelle (physique et spirituelle) doit être instituée au centre et à la source de l’élaboration du système juridique qui nous régit. Nous sommes des personnes humaines et devons être institués en droit comme étant telles.
Nous exigeons par conséquent l’abolition du statut d’affranchi et sa substitution immédiate par le statut de personne juridique humaine. Préalable, fondement et garant de la réussite de toutes institutions publiques de la MARTINIQUE.
Texte de Dominique MONOTUKA
Par Dominique MONOTUKA
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Fort-de-France
Tout juriste ou historien de bonne foi, est en mesure de constater que le statut qui nous est appliqué aujourd’hui, celui d’assimilation juridique, dit encore de département d’outre-mer, est celui d’affranchi du Code Noir généralisé à tous les Afro-descendants depuis le décret du 27 avril 1848.
Cette connaissance juridique n’était jadis niée par personne dans la colonie.
Ni par les Blancs, ni par les Afro-descendants.
C’est vain d'essayer comme le fait certains, de cacher cette vérité plus longtemps qui démontre aux Martiniquais que leur île, effectivement, est et demeure juridiquement une colonie au sens propre du terme.
Le 29 septembre 1848, Victor SCHOELCHER, s’adressant aux électeurs de la Guadeloupe et de la Martinique, en parlait sans honte ni ignorance :
« i[Moi, de mon côté, à l’Assemblée nationale où vos suffrages me donnent une place, je vous aiderai de toutes mes forces […] en provoquant et soutenant toutes les mesures propres à augmenter la prospérité des colonies, et leur complète assimilation à la France. Purifiées de la servitude, les colonies sont désormais une partie intégrante de la métropole ; disons mieux, il n’y a plus de colonies, il n’y a que des départements d’outre-mer qui doivent être régis par les mêmes lois que ceux du continent.
Mais qu’il me soit permis de vous le rappeler, frères et amis, tout ce que la France est disposée à faire pour ses départements d’outre-mer serait perdu si la discorde venait troubler leurs populations ]i» (cité dans Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, Editions Karthala, 2000, pp.1026-1027).
Le Conseil Général de la Martinique avec en son sein des Afro-descendants, assumait lui aussi ouvertement cette vérité. Le 24 novembre 1874, il adressait par exemple une requête à l’Etat français qui, s’il en était besoin, permet de démontrer la conscience qu’en avaient ces affranchis :
« Considérant que la qualité et les droits de citoyen français datent, pour les habitants des Antilles, de la fondation des colonies, que c’est le roi Louis XIII qui, dans son édit de 1642, concernant l’établissement de la Compagnie des îles d’Amérique, a voulu et ordonné : ‘‘ Que les descendants des Français habitués aux dites îles, et même les sauvages convertis à la foi chrétienne, en faisant profession, soient censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions et donations, ainsi que les originaires et regnicoles, sans être tenus de prendre lettre de naturalité...’’
i[Que loin d’être abrogée à la reprise des colonies par le roi Louis XIV sur les seigneurs, cette disposition a été confirmée, octroyée aux affranchis par l’article 59 de l’Edit de 1685 […]
Considérant donc qu’en accordant les droits politiques aux populations coloniales en 1848 et en 1870, le gouvernement n’a fait que consacrer à nouveau des droits acquis antérieurement et remettre la pyramide sur sa base suivant une parole célèbre reproduite dans la pétition du Sénat de 1865.
[..] ‘‘Qu’il y aurait lieu de soustraire les colonies au régime exceptionnel et de les faire jouir des lois et de l’administration de la Mère-Patrie, en prenant pour devise de ce grand mouvement réparateur : assimilation politique des colonies à la Mère-Patrie.’’ Émet le vœu : que les lois constitutionnelles attendues, particulièrement la loi électorale, comprennent les colonies comme terres françaises, parties intégrantes de la République, soumises à la même loi constitutionnelle, admise définitivement à la jouissance des lois et de l’Administration française ]i»
(cité dans Victor SABLÉ, La transformation des isles d’Amérique en départements français, pp. 89-92).
Le 7 décembre 1882, ce même Conseil Général persiste :
« i[Considérant que la Martinique qui est française depuis plus de deux siècles, qui jouit depuis 1870 des mêmes droits politiques que la métropole, se trouve dans les meilleures conditions possibles pour être assimilée complètement avec la mère-patrie.
Considérant qu’il importe de faire disparaître les différences humiliantes qui existent entre la colonie et un département français. […]Renouvelle en l’accentuant le vœu qu’il a émis le 24 novembre 1874 et demande que la Martinique soit constituée le plus tôt possible en département français ]i» (cité dans Victor SABLÉ, La transformation des isles d’Amérique en départements français, pp. 91-92).
Mais la conscience claire que le statut d’affranchi généralisé est celui de département d’outre-mer ne s’est malheureusement pas transmise jusqu’à nous.
En effet, bien que les élus martiniquais aient su que le statut d’affranchi était l’ordre qui nous régentait collectivement depuis 1848 ; bien qu’ils aient su et aient reconnu parfaitement que le statut d’affranchi était le même que celui d’assimilation et de département d’outre-mer, dont ils demandaient par conséquent l’application pleine et entière – comme nos élus des cinquante dernières années ont continué de réclamer – par la mise en œuvre d’une politique de rattrapage (politique que le Conseil général désigne dans sa requête de 1874 comme étant le « grand mouvement réparateur ») .
Nous allons assister durant la première moitié du 20e siècle à une étrange absence de transmission aux Martiniquais de cette mémoire, pourtant si essentielle pour la compréhension et la résolution de notre malaise identitaire colonial.
Il convient donc aujourd’hui et plus que jamais de reconquérir cette mémoire pour en tirer toutes les conséquences utiles. Parce que ce n’est évidemment pas dû au hasard si l’Etat français a continué jusqu’à aujourd’hui à nous maintenir appliqué le statut d’affranchi.
C’est en effet parce que sa Commission d'abolition de l'esclavage a été aussi convaincue que lui – en raison notamment de son échec face à la révolte de Saint-Domingue qui, en 1804, couronnait l’avènement d’Haïti – qu’il fallait immédiatement abolir le statut d’esclave et généraliser en parallèle le statut d’affranchi pour arriver à conserver entre ses mains la situation coloniale en Martinique, c’est-à-dire pour empêcher que cette terre et la main d’œuvre que continuent d’y constituer les Afro-descendants n’échappent à sa domination codifiée.
Le premier Rapport fait au Ministre de la Marine et des Colonies par la Commission d’émancipation, Commission instituée par l’Etat français pour préparer l’acte d’abolition immédiate de l’esclavage, expose clairement cette cynique analyse politique :
« L’esclavage, tout le monde en convient, et les colons sont d’accord pour le reconnaître, l’esclavage ne pouvait plus être maintenu, et l’on devra se réputer heureux si l’on a traversé sans secousse le court intervalle qui a dû séparer la proclamation de la République et l’annonce du prochain affranchissement. […]
Plus d’accommodement possible avec la servitude ; tout accommodement, comme tout mensonge, soulèverait les nègres et mettrait en péril l’existence même des colonies. Saint-domingue est là pour nous dire ce que l’on gagne à marchander, à des hommes qui veulent être libres, leur droit à la liberté.
C’est l’esclavage qui, en paralysant le travail, les a maintenues (les colonies) soit pour l’agriculture, soit pour l’industrie, à un degré si triste d’infériorité vis-à-vis de la métropole.
L’instrument humain dont on faisait usage sembla, pendant bien longtemps, dispenser le maître du moindre effort pour le bien diriger. L’agriculture employait à peine la charrue : jamais on ne fit un tel abus des forces brutes de l’homme. […] Il y avait donc une énorme déperdition de forces ; il y avait une perte énorme de produits ; et nous ne craignons pas de l’affirmer, le travail dût-il compter moins de bras, la production pourrait s’élever encore par le meilleur emploi de ceux qui resteront, le perfectionnement des instruments et la réforme des méthodes » (cité dans Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, Editions Karthala, 2000, p. 976).
Aussi, arrivaient-ils à leur fin : ce que l’Etat et sa Commission cherchaient en 1848 à gagner à marchander notre droit à la liberté, et finissaient par obtenir, est précisément notre maintient sous le statut d’affranchi.
C’est la cohérence et l’efficacité permanente du système esclavagiste qui l’exigeaient.
Les fondateurs du Code Noir étaient et demeurent intéressés uniquement – il convient de ne jamais l’oublier – par la force de travail (physique et intellectuelle) que les Afro-descendants constituent, et non point par ce qui nous distingue des animaux, je veux dire notre civilisation, notre culture qu’ils méprisent.
Et c’est ce qui explique leur décision de nous imposer systématiquement que des identités juridiques exclusives de notre être culturel (esclave, meuble et affranchi).
Car contrairement aux apparences, ce qui caractérise substantiellement la qualification juridique d’affranchi, est exactement le même crime contenu dans la qualification juridique d’esclave : l’un et l’autre ne reconnaissent point aux hommes et aux femmes auxquels ils s’appliquent la qualité fondamentale d’êtres de civilisation et de culture, donc de personne humaine.
Jadis, les Afro-descendants dénonçaient avec une admirable lucidité cette inacceptable déni d’humanité contenu dans ce statut, ainsi que ses détestables effets y compris celui de les handicaper en permanence dans leur propre pays par rapport aux colons.
Ce fut le cas par exemple d’affranchis de la Guadeloupe en 1840 : i[« […], nous mettons en usage les seuls moyens que nous ayons en notre pouvoir, ceux que nous tenons de la nature, nous voulons dire nos faibles talents, les faibles lumières de notre raison, et surtout la conscience de la dignité de notre être.
C’est avec ces armes, puissantes pour qui sait s’en servir, que nous combattons les préjugés qui planent encore sur nous, et qui ne se dissiperont que lorsque les contrées que nous habitons, n’étant plus frappées de cette prétendue naturelle incapacité, cesseront d’être considérées comme ne devant être jamais dignes de la liberté et de la civilisation ]i»
(cité dans Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, Editions Karthala, 2000, p. 682).
Par conséquent, la condition d’indignité humaine que nous éprouvons quotidiennement, n’est pas le fruit de notre imagination ni du hasard. Si l’on veut bien se rappeler que le droit, qui est une production humaine, est de la culture (ou encore de la civilisation) et que la culture est d’abord et avant tout du droit (des règles sociales).
Alors on comprendra que continuer d’œuvrer dans notre société sous le régime d’affranchi, nous réduit effectivement à ne pouvoir protéger et faire survivre notre culture (règles sociales) que dans des espaces privés de plus en plus réduits, et même souvent dans la clandestinité.
On comprendra aussi pourquoi, qu’en dépit du talent de nos artistes, de l’activisme de nos associations culturelles, de la volonté courageuse de certains de nos enseignants dans les institutions scolaires ou universitaires, de nous transmettre notre culture, nous sommes et demeurons dépossédés des moyens de faire œuvre de civilisation à la hauteur de nos ambitions, de sauvegarder comme il se doit, dignement, notre identité culturelle.
On comprendra une fois pour toutes qu’en effet, frappés comme nous le sommes dans le système juridique qui nous régente, de l’incapacité juridique de traduire notre culture en l’officiel droit public devant nous régir, est la conservation intacte et exacte de la négation même de notre droit à une identité de personne humaine.
Et pour cause ! La condition d’indignité humaine que nous éprouvons quotidiennement, c’est l’institutionnalisation à notre encontre de la règle politico-juridique selon laquelle, la manière de soumettre et d’instrumentaliser une population est l’écrasement de sa mémoire historique, la destruction de sa culture, l’épuisement de ses symboles patrimoniaux et identitaires.
La condition d’indignité humaine que nous continuons de subir chaque jour qui passe, c’est le statut d’affranchi, ce maintien raciste de l’application du Code noir qui gangrène toutes les institutions publiques et privées en Martinique.
C’est cette exclusion raciste de notre culture de l’élaboration et de l’application des institutions publiques qui nous gouvernent (droit civil, du travail, de l’éducation, de l’économie, de la justice…).
C’est pourquoi, il est plus que jamais urgent que nous allions plus loin pour la renaissance pleine et entière de notre dignité en droit, en appliquant immédiatement le statut de personne humaine au profit de notre population martiniquaise.
Je rappelle tout de même que depuis la Constitution de 1946, le statut d’affranchi dit encore d’assimilation juridique est devenu anticonstitutionnel. La Constitution française de 1946 nous a en effet reconnu – malgré elle manifestement – le statut juridique de personne humaine.
Mais l’Etat français n’a jamais procédé à son application puisqu’il nous a maintenu celle du statut d’affranchi, avec notamment la complicité du Conseil d’Etat. Mais les Martiniquais ne veulent et ne peuvent plus survivre dans ce déni d’humanité qui de surplus est illégal.
Notre force culturelle (physique et spirituelle) doit être instituée au centre et à la source de l’élaboration du système juridique qui nous régit. Nous sommes des personnes humaines et devons être institués en droit comme étant telles.
Nous exigeons par conséquent l’abolition du statut d’affranchi et sa substitution immédiate par le statut de personne juridique humaine. Préalable, fondement et garant de la réussite de toutes institutions publiques de la MARTINIQUE.
Texte de Dominique MONOTUKA
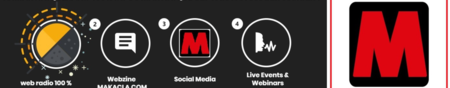

 Accueil
Accueil












